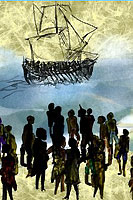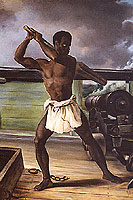|
 Le
regroupement
Le
regroupement
 Si
le bateau appartenait à une compagnie nationale, il se rendait à ses
comptoirs où les captifs étaient entreposés avant leur déportation,
mais si le navire pratiquait le commerce libre, c’est l'armateur qui
fixait les lieux de cabotage et pratiquait la traite itinérante (ou traite volante). C’est à dire que pendant
plus de trois mois le navire procédait à un lent cabotage sur les côtes
africaines, du Sénégal au Gabon, voire plus loin et entre chaque
centre négrier pour embarquer les captifs. Si
le bateau appartenait à une compagnie nationale, il se rendait à ses
comptoirs où les captifs étaient entreposés avant leur déportation,
mais si le navire pratiquait le commerce libre, c’est l'armateur qui
fixait les lieux de cabotage et pratiquait la traite itinérante (ou traite volante). C’est à dire que pendant
plus de trois mois le navire procédait à un lent cabotage sur les côtes
africaines, du Sénégal au Gabon, voire plus loin et entre chaque
centre négrier pour embarquer les captifs.
 L’embarquement
L’embarquement
 L'embarquement
des captifs se faisait par petits groupes de quatre à six personnes.
Terrorisés, certains sautaient et se noyaient pour essayer d’échapper
à leur sort. Dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés
des femmes et des enfants, les
hommes allaient sur le gaillard d'avant, enchaînés deux à deux par les chevilles (ceux
qui résistaient étaient aussi entravés aux poignets) tandis que les
femmes et les enfants étaient parquées sur le gaillard d'arrière (les
gaillards sont les parties surélevées du bateau). L'embarquement
des captifs se faisait par petits groupes de quatre à six personnes.
Terrorisés, certains sautaient et se noyaient pour essayer d’échapper
à leur sort. Dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés
des femmes et des enfants, les
hommes allaient sur le gaillard d'avant, enchaînés deux à deux par les chevilles (ceux
qui résistaient étaient aussi entravés aux poignets) tandis que les
femmes et les enfants étaient parquées sur le gaillard d'arrière (les
gaillards sont les parties surélevées du bateau).
 La
traversée
La
traversée
 Les
conditions de transport au cours du voyage étaient particulièrement
inhumaines et certains récits permettent de s’en faire une idée. Si
le temps le permettait, les déportés passaient la journée sur le pont
mais les hommes, toujours séparés des femmes et des enfants, restaient
enchaînés et pendant ce temps les bailles à déjection étaient vidées
et l'entrepont gratté et nettoyé. Pour les dégourdir et les occuper
on incitait les esclaves à danser et le soir les déportés
retournaient dans l'entrepont où les
officiers les mettaient en place pour la nuit, couchés
sur les planches et enferrés deux par deux. Le taux d'entassement était
important puisque pour gagner de la place, le charpentier construisait
un faux pont, sur les côtés permettant d'entasser des centaines de
noirs enchaînés, rangés selon le système "de la cuillère"
(emboîtés les uns dans les autres). Un navire pouvait contenir
jusqu’à six cent esclaves. Le
pire de tout était le mauvais temps car les déportés restaient confinés
dans l'entrepont et il n'y avait pas de vidange des bailles à déjection
ni de nettoyage des sols. Avec la tempête le contenu des bailles
coulait sur les planches de l'entrepont et les excréments se mêlaient
aux vomissures des malades et des victimes du mal de mer. Si les écoutilles
étaient closes, l’air irrespirable, l’obscurité et le roulis
affaiblissaient les captifs et au cours
de la traversée, le stress et les maladies en emportaient souvent un
sur huit. Les
conditions de transport au cours du voyage étaient particulièrement
inhumaines et certains récits permettent de s’en faire une idée. Si
le temps le permettait, les déportés passaient la journée sur le pont
mais les hommes, toujours séparés des femmes et des enfants, restaient
enchaînés et pendant ce temps les bailles à déjection étaient vidées
et l'entrepont gratté et nettoyé. Pour les dégourdir et les occuper
on incitait les esclaves à danser et le soir les déportés
retournaient dans l'entrepont où les
officiers les mettaient en place pour la nuit, couchés
sur les planches et enferrés deux par deux. Le taux d'entassement était
important puisque pour gagner de la place, le charpentier construisait
un faux pont, sur les côtés permettant d'entasser des centaines de
noirs enchaînés, rangés selon le système "de la cuillère"
(emboîtés les uns dans les autres). Un navire pouvait contenir
jusqu’à six cent esclaves. Le
pire de tout était le mauvais temps car les déportés restaient confinés
dans l'entrepont et il n'y avait pas de vidange des bailles à déjection
ni de nettoyage des sols. Avec la tempête le contenu des bailles
coulait sur les planches de l'entrepont et les excréments se mêlaient
aux vomissures des malades et des victimes du mal de mer. Si les écoutilles
étaient closes, l’air irrespirable, l’obscurité et le roulis
affaiblissaient les captifs et au cours
de la traversée, le stress et les maladies en emportaient souvent un
sur huit.
 Les
révoltes à bord
Les
révoltes à bord
 Quelquefois
des révoltes éclataient à bord dont la plupart se réalisaient le
long des côtes africaines car en haute mer les réussites étaient
beaucoup plus rares. Un voyage sur dix s’accompagnait d’une
insurrection dont quelques unes réussissaient, mais la plupart du temps
elles étaient matées. Quelquefois
des révoltes éclataient à bord dont la plupart se réalisaient le
long des côtes africaines car en haute mer les réussites étaient
beaucoup plus rares. Un voyage sur dix s’accompagnait d’une
insurrection dont quelques unes réussissaient, mais la plupart du temps
elles étaient matées.
Pour
servir d'exemple, les châtiments infligés aux meneurs des révoltes étaient
brutaux, voire barbares : pour épouvanter les autres captifs ils
étaient battus publiquement et pendus, parfois on leur coupait la main,
puis on leur tranchait la tête et le torse était hissé sur le mat
pour être exhibé.
 La
mortalité des déportés durant la traversée
La
mortalité des déportés durant la traversée
 La
durée du voyage, l'état sanitaire des esclaves avant l'embarquement,
le manque d'hygiène, les épidémies de dysenterie et la promiscuité,
plus quelquefois l'insuffisance d'eau et de nourriture (ou leur avarie)
en cas de prolongement de la traversée, entraînaient un taux de
mortalité qui dépassait 12 %, mais en cas de révolte, de naufrages,
d’épidémies graves et contagieuses, il dépassait 40% et pouvait
atteindre 100 %. Les enfants étaient les plus fragiles et les femmes
les plus résistantes. La
durée du voyage, l'état sanitaire des esclaves avant l'embarquement,
le manque d'hygiène, les épidémies de dysenterie et la promiscuité,
plus quelquefois l'insuffisance d'eau et de nourriture (ou leur avarie)
en cas de prolongement de la traversée, entraînaient un taux de
mortalité qui dépassait 12 %, mais en cas de révolte, de naufrages,
d’épidémies graves et contagieuses, il dépassait 40% et pouvait
atteindre 100 %. Les enfants étaient les plus fragiles et les femmes
les plus résistantes.
 La
durée du transport
La
durée du transport
 L’élément
le plus important est la vitesse car plus courte sera la traversée,
plus faibles seront les pertes. Selon le navire et les points de départ et
d'arrivée du trajet, la traversée pouvait être très différente
(elle durait généralement entre un et trois mois). Par exemple pour un navire partant d'un port français
(17 ports français participèrent a plus de 3000 expéditions négrières),
il faut compter 2-3 mois pour atteindre l'Afrique; 3-4 mois de cabotage
sur les côtes africaines entre chaque centre négrier (ou chaque
comptoir) pour embarquer les captifs, puis encore 2-3 mois pour
atteindre les côtes Antillaises, alors
que d’Angola les Portugais rejoignaient le Brésil en un mois.
(Suite...) L’élément
le plus important est la vitesse car plus courte sera la traversée,
plus faibles seront les pertes. Selon le navire et les points de départ et
d'arrivée du trajet, la traversée pouvait être très différente
(elle durait généralement entre un et trois mois). Par exemple pour un navire partant d'un port français
(17 ports français participèrent a plus de 3000 expéditions négrières),
il faut compter 2-3 mois pour atteindre l'Afrique; 3-4 mois de cabotage
sur les côtes africaines entre chaque centre négrier (ou chaque
comptoir) pour embarquer les captifs, puis encore 2-3 mois pour
atteindre les côtes Antillaises, alors
que d’Angola les Portugais rejoignaient le Brésil en un mois.
(Suite...)
|